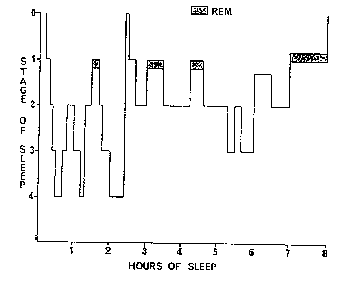Alimentation saine et hygiène
de vie
Alimentation saine et hygiène
de vie
Définition
- basée sur l'expérience et les résultats d'études
statistiques sur les habitudes alimentaires et le style de vie dans leur
ensemble (antécédents familiaux, tabagisme, pratique d'un
sport, consommation d'alcool, etc...)
- sélection de tranches de la population selon l'espérance
de vie, servant de tableaux de référence pour les sociétés
d'assurances.
Invariables
- âge
- sexe
- antécédents familiaux :
détermination génétique ou héritage d'habitudes
alimentaires et style de vie ?
Variables
- poids
- habitudes alimentaires
- exercice physique
- tabagisme
- consommation d'alcool
- schéma du sommeil
- prise de médicaments
- etc,...
L'obésité
A partir de quand ? De combien ?
- Poids relatif, c-a-d par rapport au reste de la population ; en terme
de percentiles. (P20, P97...): danger de sous-estimation de l'obésité
(ex : USA)
- Body Mass Index (BMI) : le poids en kg, divisé par le carré
de la taille en mètre. (de 25 à 30 = au-dessus de la normale.
>30 = obésité)
- Poids idéal :
- obésité à partir de 20 % au-dessus du poids
idéal.
- Méthode des plis cutanés (surtout le triceps et sous-scapulaire).
- Rapport périmètre thoracique I périmètre
abdominal.
Pour les pilotes, exigences spécifiques :
- performances du siège éjectable
- ergonomie du cockpit
- aptitude et résistance physique (mission completion)
Cause
- besoins énergétiques quotidiens: 27 à 32 kcal
par kg de poids corporel.
- contrôle par deux centres nerveux (hypothalamus):
- centre de la satiété
- centre de la faim
- Répartition des dépenses:
- métabolisme de base (60 à 75 %)
- thermogénèse liée à l'activité
physique
- réponse thermique à l’alimentation (digestion, absorption
et métabolisation)
Conséquences
a. Risque cardio-vasculaire accru:
-hypertension artérielle
-athérosclérose accélérée (infarctus,
accidents vasculaire cérébral, annévrysme)
b. Diabète sucré:
- non-insulino-dépendant le plus souvent.
c. Lithiases biliaires plus fréquentes
d. Augmentation de la fréquence de certains cancers.
e. Risque accru de mort subite (syndrôme des apnées du
sommeil,...)
Que faire?
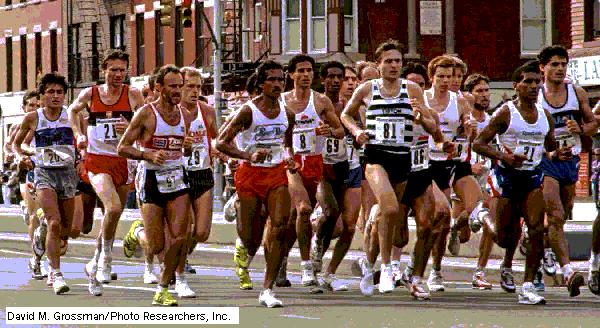
- Le sport seul ? inefficace pour faire maigrir, très efficace
comme stimulant de l'appétit.
L'obésité est plus souvent une cause d'inactivité
physique qu'une conséquence.
Alimentation saine
Intérêt en aéronautique?
De 1991 à 1994, au sein de l'USAF, se sont produits 61 incidents
consécutifs à un repas manqué ou à de mauvaises
habitudes alimentaires: entre autres plusieurs cas de vision en tunnel,
nausées, hypoxies, et même deux G-LOC.
Que faut-il manger?
- Besoins quotidiens pour un pilote: entre 2300 et 2900 KCaI
- Répartition d'apport énergétique conseillée
pour un homme de 70 kg, avec une activité physique moyenne:
- protéines: 8 % des calories
- hydrates de carbone: minimum 55 % (surtout des sucres lents)
- graisses: maximum 30 %
- Etude de l'apport énergétique dans une population de
pilotes de chasse (USAF1994) :
- protéines: 15 %. L'excédent en protéines est
transformé en sucres ou graisses.
-hydrates de carbone: 45 % dont la moitié est constituée
de sucres rapides (faible poids moléculaire), entraînant une
résorption rapide et donc une réponse insulinique trop forte,
avec, à la clé, risque d'hypoglycémie (au cours de
la quatrième heure après le repas)
- graisses: 34 % (moyenne population US: 45 %)
- alcool: 5 %. (Parmi les pilotes plus âgés, jusqu'à
11 % en moyenne!)
Commentaire
- Les hydrates de carbone complexes, au poids moléculaire élevé
(sucres lents), pris avant l'effort, augmentent le niveau des prestations.
- Un déficit en hydrates de carbone entraîne rapidement
une importante perte de rendement:
- fatigue
- manque de concentration
- augmentation du temps de réaction.
- Les hydrates de carbone simples, ou sucres rapides ("quick-snacks",
Mars, soft drinks, même les frites,...) peuvent provoquer une réaction
insulinique exagérée avec hypoglycémie.
- La tolérance aux G augmente chez les pilotes rassasiés,
et diminue en cas de déficit hydro-sodé.
L’exercice physique
Le pilote est le facteur limitant du binôme "homme-avion de chasse
moderne". L'augmentation du rayon d'action ainsi qu'une automatisation
toujours plus poussée des nouveaux appareils obligent également
les pilotes de ligne à un bon maintien de leur condition physique.
Effets recherchés de l'exercice physique:
| - direct |
- réducteur de stress. |
| - Préventif : |
- diminution des blessures consécutives aux G
- diminution des facteurs de risques cardio-vasculaires
- augmentation du capital osseux.
- prévention du diabète type Il (non-insulino-dépendant).
- amélioration de la santé mentale.
- diminution de la consommation en alcool et tabac. |
|
|
| - amélioration de I'opérationnalité: |
- comme homme entraîné
- meilleure tolérance aux G
- meilleure endurance aux G. |
|
|
| - sécurité aérienne: |
tolérance et résistance à l'effort = moins d'erreurs. |
Intérêt de l'entraînement spécifique
pour pilotes "High-Sustained G"
1. Importance de la charge anaérobe pendant la "Anti-G Straining
Manoeuvre" (AGSM)
- à 5G: O % de la contraction volontaire maximale pendant l'AGSM
- à 6G:25%
- à7G:50% (durée max.: 45 sec.)
- à 8G:75% (durée amx. : 30 sec.)
- à 9G: 100% (durée max.: quelques sec.)
Donc, G-LOC à 7Gaprès 45 secondes de contraction volontaire
maximale.
2. Importance de l'interval-training, power-training, squash, badminton,
Diminuer l'entraînement de fond.
Efficacité de l'exercice physique sur le système
cardio-vasculaire:
Au moins. 2 fois la fréquence
cardiaque de repos,
pendant 20 minutes,
3 fois par semaine"
Le sommeil
- 1/3 de la vie passée à dormir
- importance accrue d'un bon repos : automatisation du cockpit
plus grand rayon d'action
- les cycles du sommeil.
- REM: Rapid Eye Mouvement: diminue avec l'âge, certains somnifères
et l'alcool.
- Corrélation entre la température corporelle et le stade
d'endormissement:
- Le REM paraît facilité par une T° corporelle basse.
- Si l'endormissement se fait à basse T°, le REM apparaît
plus tôt.
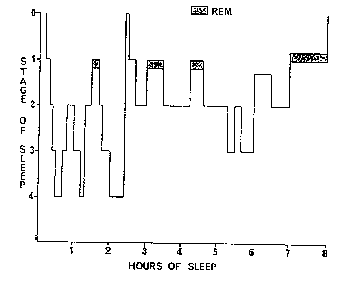
- les rythmes circadiens
- la plupart des circuits métaboliques respecte une périodicité
circadienne, c-â-d. un
rythme dont la fréquence tourne autour des 24 heures (23 à
27)
(synthèse de cortisol, d'adrénaline, la production d'urine,
la T0 corporelle,...)
- le Jet-Lag
= fatigue, perturbation du rythme veille-sommeil et d'autres rythmes
physiologiques après un vol croisant plusieurs fuseaux horaires.
- notre horloge interne a une fréquence spontanée de 25,5
heures, raison pour laquelle le jet-lag est plus important après
un vol vers l'Est (le raccourcissement de la période est moins bien
supporté).
-resynchronisation après un vol vers l'Est: +1-1,5 jour par fuseau
horaire croisé.
- Comment limiter le jet-lag?
- séjour court (1 à 3 nuitées): garder le "home-base
time" ( crewrest facilities!)
- séjour plus long: synchronisation avec l'heure locale, à
initier avant le départ, en
raccourcissant ou prolongeant les journées précédant
le départ (1 heure par jour)
Mélathonine:
- augmente lorsque la lumière ambiante diminue.
L'alcool
- 90% de la population boit au moins une fois de l'alcool dans sa vie.
- 40 à 50 % de la population masculine connaît un "problème"
passager.
- 10 % des hommes et 3 à 5 % des femmes connaissent un problème
persistant.
- seulement 5 % des alcooliques ont un comportement de "pochard".
- Culturellement accepté et même promu
- "Une affaire de gros sous"
Pharmacologie
- molécule peu ionisée:
|
- traverse facilement les membranes cellulaires
- équilibre osmotique rapidement atteint
- hydrophile et lipophile
|
<la molécule d'alcool éthylique atteint tous les compartiments
du corps>
Physiologie
1. narcotique : -diminue l'activité du système nerveux,
central et périphérique.
- potentialise l'action de certains médicaments
(barbiturates, benzodiazépines,...)
a. ralentissement psycho-moteur, même à faible concentration:
0,1 g promille (pm)
- augmentation du temps de réaction
- diminution des performances visuelles
- mauvaise estimation des distances
b. modification du comportement ( 0,1 g pm)
- disparition du "frein social", plus sociable, plus Ioquace.
- diminution du contrôle de soi. Impression que tout fonctionne
normalement.
c. narcose et sommeil profond: souvent déjà à
partir de 1,5 g pm.
d. décès: chez certains à partir de 3 g pm.
e. troubles résiduels, après disparition de l'alcool
du sang.
- troubles de l'humeur: irritabilité, asthénie.
- augmentation de la tension artérielle, durant plusieurs jours
(paradoxe français).
- augmentation du pouls cardiaque.
- modification des concentrations hormonales (cortisol, adrénaline,
hormones sexuelles).
- diminution de la résistance au stress.
- "After-effects"
- After-effects, spécifiques au personnel navigant:
a. Plus grande sensibilité à la désorientation
spatiale:
- persistance de l'alcool dans l'endolymphe des canaux semi-circulaires
- différence de densité
- provoque le PAN ("Position Alcohol Nystagmus")
- dure jusqu'à 36 heures après consommation raisonnable
- perceptible jusqu'à 48 heures sous l'influence des G (àpartirde2à3G)
b. Perturbation de la coordination motrice fine:
- manipulation du mauvais switch
- non-enclenchement du switch
Tolérance à l'alcool
- Varie selon - le sexe (homme > femme)
- le poids corporel
- habitudes de consommation
- prise ou non de médicaments.
- effet de compensation par consommation régulière (habituation)
- induction hépatique: le foie métabolise plus rapidement
l'alcool, mais aussi bon nombre de médicaments
- la membrane cellulaire devient moins perméable à l'alcool
- apprentissage du corps à fonctionner sous influence de l'alcool
- Désavantage de l'habituation = la dépendance
à l'alcool
les cellules nerveuses deviennent dépendantes de l'alcool normalement
pour fonctionner
Alcoolisme
OMS: "lorsque l1abus d'alcool atteint l'intégrité physique,
mentale et sociale de l'individu de manière répétée".
| Danger: |
- boire seul régulièrement
- vider son premier verre d'un trait
- boire davantage pour se sentir mieux
- tremblements matinaux
- sentiment de culpabilité au moment de boire
- irritabilité si reproches quant à la consommation d'alcool
- influence quelconque sur la vie familiale, professionnelle ou sociale
du sujet. |
Et dans l'aviation?
- 1960 (USA): 40 % des accidents: alcool retrouvé dans le sang
des pilotes
- 1994 (Pays-Bas) étude sur simulateur de vol :
| 0,75 I de bière (pils) : |
2 fois plus d'accidents |
| 1,25 l |
4 fois |
| 1,5 l |
6 fois |
| 2,5 l |
25 fois |
Cette étude a également montré que de faibles quantités
d'alcool dans le sang
rendent l'exécution de tâches complexes impossible, et
entraînent la fixation de
l'attention sur une tâche unique.
Conclusion
FAA: 8 heures "between the bottle and the throttle" KLu (Force Aérienne
des Pays-Bas): 10 heures
Le tabac
Effets cliniques
1. Nicotine: (alcaloïde puissant)
- cardio-vasculaire, augmentation du pouls et de la tension artérielle,
de l'excitabilité du muscle cardiaque, de la consommation en 02,
vasoconstriction
- variation des concentrations en cortisol, glucose, acides gras, adrénaline,
endorfine
- responsable de la dépendance au tabac
2. Monoxyde de carbone (CO)
- liaison avec hémoglobine 300 fois plus forte que l'02
- bloque 2 à 15 % de l'hémoglobine circulante
chez un fumeur moyen (20 cigarettes lj): 5 % de l'Hb conséquences:
polycythémie et augmentation de la viscosité sanguine
3. Hydrocarbures:
- cancérigènes pour :
langue, lèvres, gorge, bronches
œsophage, estomac rein,
vessie pancréas col utérin
(USA: 30 % des cancers sont dûs à la cigarette)
- délétères pour les poumons (bronchite chronique
et emphysème)
- grossesse:
- poids de naissanoe inférieur de 170 g (moyenne!)
- risque accru de fausse-couche, mort-né et de mort subite chez
le nourrisson
- croissance freinée et limitation du dévéloppement
intellectuel de l'enfant

Conséquences en aéronautique
2. Economiques :perte en journées de travail
3. Opérationnelles : diminution de la tolérançe
aux G coordination neuro-musculaire diminuée.
La caféine
- famille des xanthines (théophylline)
- issue de plantes: graine de café (Arabica> Robusta), thé,
cacao, cola
- est la "drogue" la plus utilisée au monde.
- est le composant alimentaire le plus puissant quant à ses
effets cliniques.
| - Café : |
- goutte-à-goutte
- percolé
- Nes
- décafféiné |
110 mg par tasse
80 mg
60 mg
2 à 5 mg
|
|
|
|
| - Thé |
- 1minute
- 3 minutes
- 5 minutes |
9 à 30 mg
20 à 46 mg
30 à 50 mg |
| -Cola classique: |
|
25 cc 45 mg (idem pour le "Light") |
| - Seuil toxique: |
|
1000 mg par jour. |
- Consommation quotidienne moyenne en Europe: 245 mg.
Effets cliniques
- Doses faibles (100 mg/jour): stimule l'attention visuelle et auditive
- Doses moyennes (200 à 400 mg/j): stimule l'état d'alerte
consciente générale.
- Doses fortes (> 800 mg/j): effets pervers
- perturbation de la coordination motrice fine
- légère fatigue à abattement profond
- stress
- Insomnie
- irritabilité, dépressivité
- Apparition d'une tolérance relative par consommation chronique
- Syndrôme de sevrage: fatigue, stress et irritabilité
MEDICAMENTS ET PERSONNEL NAVIGANT
1. Les membres du personnel navigant sont, comme tous les autres hommes,
sujets à la maladie, aux malaises et à la fatigue.
2. Certains prennent des médicaments sans avis médical
(médicaments ne nécessitant pas de prescription) ou reçoivent
des médicaments d’un médecin non familiarisé avec
les problèmes de médecine aéronautique.
Beaucoup de médicaments ne possèdent pas seulement l’action
pharmacodynamique recherchée mais aussi très souvent des
effets secondaires très importants.
3. Parmi les effets secondaires de beaucoup de médicaments on
trouve :
- une action perturbatrice des fonctions circulatoire et respiratoire
dont l’importance en vol ne doit plus être soulignée ;
- un amoindrissement ou une perturbation de la vision ou de l’audition,
alors que leur bon fonctionnement est indispensable à l’aviateur
;
- un amoindrissement de l’état de vigilance, de certaines qualités
sensori-motrices ou de certaines qualités mentales nécessaire
à la sécurité du vol.
Bien souvent, la nature même de la maladie pour laquelle le médicament
est prescrit impose l’interdiction de voler.
La règle générale de n’autoriser l’emploi d’aucun
médicament en période d’activité aérienne doit
être considérée comme un point fondamental, avant toute
autre considération pratique. Dans certaines conditions, on autorisera
des exceptions après vérification et étude approfondie
de toutes les données des cas en cause :
*Les analgésiques légers de la famille de l’aspirine à
dose limitée.
*Les décongestionnants du nez présentés sous forme
de gouttes ou contenus dans un petit vaporisateur de poche, sont sans danger
si l’utilisateur s’en sert avec discernement et sans excès, c’est-à-dire
selon le mode d’emploi recommandé.
*Les sédatifs hypnotiques à effets courts uniquement lorsque
c’est indispensable.
*Certains hypotenseurs diurétiques à faible dose.
*La nivaquine pour la prévention de la malaria dans les pays
chauds.
*Certains antigoutteux : Xyloric.
Comme règle générale, on admet qu’un aviateur ne
doit pas employer de médicaments huit heures au moins avant toute
mission aérienne, et seize heures au moins avant toute mission aérienne
s’il s’agit de médicaments ayant des effets prolongés.
MALAISES EN VOL CHEZ LE PERSONNEL NAVIGANT
1. Définitions
Malaise en vol = prise de conscience d’un état pénible,
altérant les moyens de perception et de réaction, mais qui
n’annihile pas complètement la conscience et l’instinct de conservation.
Difficile, de le différencier de la perte de connaissance, à
laquelle il peut aboutir et dont il partage les étiologies.
Il faut le distinguer de l’incapacité soudaine en vol = perte
de contrôle de l’avion par le pilote, à cause d’une affection
organique (infarctus du myocarde, colique néphrétique, crise
d’épilepsie postraumatique, etc…)
2. Fréquence
La fréquence exacte des malaises en vol est difficile à
évaluer et toutes les statistiques publiées pêchent
certainement par défaut.
Problèmes :
- non rapporté
- non reconnu
- banalisation
- « accident sans cause connue »
LOC : actuellement surtout en raison d’un rapide +GZ onset en dehors du
palier du voile noir
- documenté en centrifuge
- documenté dans avion avec co-pilote.
3. Etiologie
a. Facteurs aéronautiques
- Hypoxie (panne, réserve, étanchéité,….)
- Problèmes de pressurisation (aéroembolisme, dysbarisme
oreilles/intestins)
-Accélérations principalement +Gz- LOC
- Sommation d’accélérations
- Mal de l’air
- Principalement chez les élèves
- Formes frustes avec hypersialorrhée, nausées, baillements,…)
- Désorientation
- Angoisse, tachycardie, perturbations intestinales.
- Problèmes de température :
- Vêtements protecteurs (par perturbations et défauts d’O2,
G-suit, combinaison pressurisée, respiration en suppression).
b. Facteurs humains somatiques
- Affections rhumatismales
- Affections orl
Dysfonctionnement tubaire
- Affections cardio-vasculaires
- Affections gastro-intestinales
Colopathie chronique ? dilatation gazeuse ? crampes avec effet neurovégétatif
- Affections neuro-sensorielles
Vision p ex vision double par O2
- Affections métaboliques
Hypoglycémie, syndrome neurovégétatif
Fatigue - perturbation rythme circadien
Hyperventilation
Personnalité
Spasmophilie
Facteurs externes
c. Facteurs psychologiques
(> 1/2) souvent facteur principal ou déclenchant
- Névrose d’angoisse et/ou ses équivalents somatiques.
- Névrose post-traumatique (d’autres problèmes semblent
se focaliser sur un accident aérien antérieur).
Le milieu des pilotes se coupe de cela (dynamique de groupe)
- Dérèglement neurovégétatif.
Perturbation de l’adaptation vasomotrice.
Symptômes vaso-vagaux.
4. Syndromes
(Ref : G. LEGAY et al, médecine et armées, 1982)
| Mal de l’air |
16% |
| Hyperventilation |
8% |
| Désorientation |
17% |
| Hypoglycémie |
11% |
| Crise d’angoisse |
17% |
| Dystonie neurovégétative |
18% |
| Lipothymie |
7% |
| Affection organique |
17% |
| Indéterminé |
17% |
| Causes aéronautiques |
7% |
- Eléments pour l’enquête étiologique :
- approfondie !
- fiche d’incident !
- Vie extra-professionnelle :
- stabilité
- moments-clefs (mariage, divorce, décès, déménagement….)
- Age et expérience :
- jeune : non adapté
- âgé : motivation , bien-être somatique
- Spécialité, type d’avion, nature de la mission (par ex
chasse)
5. Clinique (symptômes)
-Perturbation psychique (2 aspects essentiels)
- Angoisse (incertitude, peur de perte de contrôle, peur de la
mort) sans objet, panique.
- Capacités intellectuelles , abrutissement, perte de force,
vivacité diminuée, attention, initiatives,
concentration.
- Asthénie : psychologique et physique : apparition brutale, parfois
localisée «jambes de flanelle »)
- Perturbations sensorielles
|
|
- champ visuel,changements, formation d’images de «mouches »,
éblouissement |
-
Troubles de l’équilibre :
|
- « chute », horizon qui bouge, désorientation |
|
|
- paresthésies
- céphalées, impression que le casque et le masque serrent |
|
|
- cardiaques : - tachycardie, palpitations, précardialgies,
impression d’arrêt cardiaque |
|
- respiratoires : dyspnée, polypnée profonde, douleur
- digestives : nausées, vomissements, troubles abdominaux, ballonnement,
coliques, transpiration, sialorrhée.
- transpiration chaud/froid. |
|
|
|
6. Pronostic et évolution
|
|
favorable |
répétitions |
consulter |
|
grave |
répétitions |
consulter |
|
|
fonction de l'étiologie |
claire |
solution/décision claire |
|
|
complexe |
|
Etude Pasquier 93 pilotes MEV
-
11 immédiatement inaptes
-
17 reclassés
-
20 plus tard à nouveau MEV.
Propylaxie
-
Amélioration des «moyens de protection »
-
Meilleure information du PN
-
matériel
-
risques, symptômes, mesures
-
Détection des personnes à risques :
-
affections
-
perturbations fonctionnelles latentes
-
conflits psychologiques
-
Collaboration parfaite Med - Comdt - Centre.
MALADIES ET ACCIDENTS A BORD : PASSAGERS
1. Facteurs Déterminants
- Facteurs Humains :
- Age (jeune/vieux)
- Maladies (connues, inconnues)
- Sensibilité au mal de l'air
- Stress
- Facteurs du Vol :
- Hypoxie relative
- Climatisation (sec, T°)
- Position (assis, immobile)
- Turbulence
- Pressurisation (oreilles, dents, intestins)
- Nourriture
- Sommeil (perturbation)
- Accidents et Incidents :
- Chute
- Turbulence
- Décompression
- Atterrissage brutal
2. Affections
(Etude Air France, 1978-1979, 1200 affectionsIan 1 événement
médical/17.300 personnes)
Causes principales %
-
Malaises
-
Blessures
-
Gastro-intestinal
-
Cardio-vasculaire
-
ORL
-
Gynéco
-
Urologie
-
Neuropsychiatrie
-
Allergie
-
Infections
-
Divers
|
40%
30%
6%
6%
5%
3%
3%
2%
2%
1%
2% |
145 cas graves (12%)
585 interventions de médecins (1/2 méd. à bord)
379 emplois de la trousse médecin
7 cas d'assistance radio
2 cas de détournement de l'avion
3. Affection graves
-
Mort 6 (3 cardiaques)
-
Angine de poitrine 29
-
Abdomen aigu 12
-
Colique néphrétique 26
-
Accouchements 4
-
Saignement gynéco 3
-
Hémiplégie 1
-
Coma diabétique 1
|
(3 cardiaques)
29
12
26
4
3
1
1 |
Il va de soi que l’approche de telles situations doit être
enseignées au personnel et que les trousses d’urgence doivent être
prévues en fonction de celles-ci.
4. Aperçu détaillé
a. Malaises 40%
Souvent provoqués par différents facteurs comme les accès
d’angoisse (peur du vol), l’abus d’alcool, une alimentation perturbée,
le stress…Le plus souvent syndrome vagal, parfois hyperventilation.
| b. Blessures (30 %) |
+/- 20% par les turbulences
+/- 80%sans rapport avec le vol, souvent pendant l’embarquement ou
le débarquement
(chute, chute d’un bagage, plaie) |
|
|
|
Plaie ou brûlure
Contusion
Entorse
Dent cassée
Corps étranger dans la bouche ou l’œil
Ongle cassé
Fracture |
75%
30%
4%
2%
2%
1%
1cas |
c. Symptômes gastro-intestinaux 6%
Abdomen aigu
Abdomen subaigu
Diarrhée aiguë
|
15%
65%
20% |
Dans les 12 cas aigus, une urgence chirurgicale fut suspectée.
Les causes principales furent :
Appendicite, obstruction intestinale, saignement gastrique, cholécystite,
coliques hépatiques, pancréatite.1 patient fut déposé
lors d’un atterrissage
intermédiaire.
Les cas subaigus ne causèrent pas d’interruption de vol. Une
diarrhée importante peut parfois apparaître en raison d’un
dérèglement alimentaire mais est le plus souvent provoquée
par les facteurs toxi- infectieux. Chez les nourrissons ceci peut constituer
un risque.
d Syndromes cardio- vasculaires 6%
Oppression (malaise) chez des patients cardiaques connus
Angor
Oedémie aigu du poumon
Phlébite
|
55%
41%
3%
1% |
Ces affections sont généralement anxiogènes. Elles
provoquèrent 3 morts et 3 détournement de l’avion.
Un arrêt cardiaque fut réanimé pendant le vol.
e. ORL 5%
Saignements du nez
Barotrauma (oreille)
Barotrauma (sinus) |
76%
15%
9% |
Les barotraumatismes sont certainement beaucoup plus fréquents mais
sont moins rapportés et apparaissent souvent pendant l’atterrissage
(sous-pressurisé).
f. Gynéco 3%
Menace de fausse couche
Accouchement (4)
Grossesse extra utérine
Malaise pendant grossesse |
12%
12%
12%
12% |
un accouchement prématuré n’est pas directement provoqué
par le vol. Ce sont les circonstances de vol qui jouent un rôle (fatigue,
angoisse, stress, déplacements à pied, port de valises, position….)
g. Urologie 3%
Colique néphrique 89%
Cystite aiguë 70%
Rétention d’urine 4% |
89%
70%
4% |
Les coliques néphrétiques sont plus fréquentes
de par le manque de boissons et le décalage horaire.
a. Autres causes fréquentes
Epilepsie (37 cas)
Urticaire (10)
Asthme (9)
Fièvre (8)
Douleur articulaire (8)
Intoxications (6) |
Rem : parfois faux diagnostic
Rem : D D Hyperventilation ?
Rem : Alcool + médicaments |
-Top-